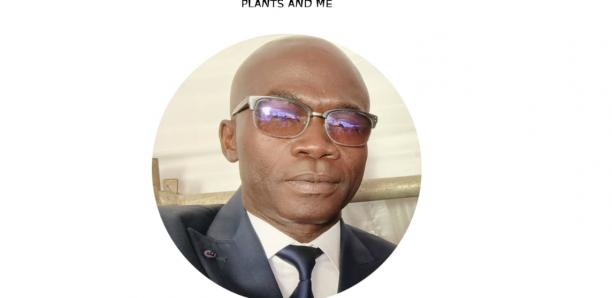
Au cœur de la culture sénégalaise réside une tradition immémoriale du palabre, de la concertation et de la médiation. Le dialogue n’est pas une invention moderne dans notre société : il est une matrice sociale, une aspiration à une vie apaisée, saine et harmonieuse au sein de la communauté. C’est dans les cases, sous l’arbre à palabre ou autour du feu de bois que nos ancêtres résolvaient les conflits, partageaient les responsabilités et scellaient les décisions collectives.
Ainsi, l’appel au dialogue national initié par Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal, s’inscrit dans la continuité d’une pratique enracinée dans l’histoire de notre pays. Il est une incarnation de notre devise nationale : « Un Peuple - Un But - Une Foi », mais surtout, de ce que le sociologue Ferdinand Tönnies appelait la communauté organique, au sein de laquelle « les liens humains précèdent les institutions ».
La philosophie africaine traditionnelle l’enseigne à travers le principe d’Ubuntu, résumé dans cette maxime : « Je suis parce que nous sommes ». Ce principe constitue le soubassement du dialogue national – une volonté délibérée de faire société ensemble – que le préambule de notre constitution exprime dans les termes sublimes du « commun vouloir de vie commune ».
Fort de cet héritage culturel et politique, il me paraît opportun de revisiter le dialogue national non seulement comme une expression de notre identité collective, mais également comme un levier stratégique. Il apparaît à cet égard comme une constante historique, un enjeu de cohésion sociale, une opportunité pour l’opposition et une condition essentielle pour faire aboutir des objectifs communs.
Depuis les premiers balbutiements de notre indépendance, le dialogue fut souvent invoqué comme un instrument de stabilité. Sous Léopold Sédar Senghor, l’intellectuel et homme d’État, le pluralisme politique fut progressivement accepté, marquant une ouverture à la concertation. Abdou Diouf, homme de consensus, s’illustra par son attachement au dialogue avec les partis d’opposition, ce qui valut au Sénégal la réputation de démocratie modèle. Abdoulaye Wade, quant à lui, a institutionnalisé plusieurs forums de dialogue politique. Macky Sall a poursuivi cette dynamique en convoquant des concertations nationales, dont la plus récente remonte à février 2024.
Mais l’histoire nous enseigne également que nombre de ces dialogues ont échoué, faute de volonté politique pour traduire les conclusions en actes. Comme le disait Hannah Arendt : « Le plus grand ennemi de la vérité n’est pas le mensonge, mais l’oubli. » Il est donc impératif d’ancrer le dialogue actuel dans une logique de continuité et de crédibilité en raison de son enjeu crucial.
La sous-région ouest-africaine est aujourd’hui marquée par une insécurité endémique, due à l’expansion de mouvements réputés terroristes et à la fragilité des États. Le Sénégal, par sa stabilité, fait figure d’exception. Mais cette exception ne saurait être un rempart si la cohésion nationale venait à se fissurer.
Le dialogue national devient alors un rempart contre la désunion. Le philosophe Emmanuel Kant affirmait que « la paix n’est pas un état naturel, mais un devoir ». Ce dialogue est donc un devoir patriotique, un outil de prévention et un exercice de catharsis nationale. Il peut renforcer le contrat social, réduire les frustrations, intégrer les marginalités et redonner au peuple sénégalais une foi renouvelée en la République. Il apparaît ainsi comme une belle opportunité pour l’opposition.
L’opposition sénégalaise est face à une chance inédite : celle de participer à un dialogue initié non pas pour la forme, mais pour refonder. Le leadership du Premier Ministre Ousmane Sonko, figure emblématique de la nouvelle génération politique, donne à cette initiative un souffle populaire et une légitimité charismatique rarement égalée.
Ne pas répondre à cet appel serait, pour l’opposition, risquer de se couper d’une dynamique historique. Antonio Gramsci avertissait que « l’histoire enseigne mais elle n’a pas d’élèves ». L’opposition saura-t-elle, cette fois-ci, apprendre de ses erreurs passées ?
Au demeurant, ce dialogue est un espace pour faire entendre une pluralité de voix, dans le respect mutuel et l’intérêt supérieur de la Nation. Il est compatible avec les enseignements tirés de la Sourate Al-Imran, verset 159 : « Et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t’es décidé, place ta confiance en Allah ». Ce verset montre que même le Prophète Muhammad – paix et salut sur lui –, bien qu’inspiré par la révélation, était invité à consulter ses compagnons sur les affaires collectives. Cela témoigne de la valeur cardinale du choura (la consultation), principe coranique qui fonde le dialogue et la participation collective à la décision dans l’intérêt général.
La crédibilité de ce dialogue dépendra de sa capacité à produire des effets tangibles. Rien ne serait plus destructeur que de donner au peuple l’illusion d’un énième forum sans lendemain. Comme le disait le prophète Ésaïe : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » (Ésaïe 29:13). Que l’État n’honore pas ce dialogue uniquement par des discours mais qu’il en incarne l’esprit et exécute les recommandations issues des débats.
Le politologue français Jean Leca nous rappelle que « les institutions démocratiques ne valent que par la confiance qu’elles inspirent ». Une mise en œuvre réelle des conclusions renforcerait cette confiance et donnerait un nouvel élan à notre démocratie.
En conclusion, nous pouvons retenir que le dialogue national n’est pas une faveur accordée par le pouvoir à l’opposition, à la société civile ou à quelque composante que ce soit de la communauté. Il est une exigence du vivre-ensemble, un moment de vérité collective. Il appelle à la responsabilité de chacun et à l’engagement de tous.
À l’heure où le Sénégal entame un nouveau chapitre de son histoire, sous le regard attentif du monde, l’opposition a le devoir impérieux de répondre à l’appel de la patrie, du destin national. Car comme l’écrivait Aimé Césaire : « Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes est une civilisation suicidaire ». Que les représentants du peuple – partis politiques, associations, syndicats, leaders d’opinion, chefs religieux et coutumiers – fassent du dialogue national un pacte fondateur, un pacte sincère et durable. L’histoire nous prête l’hospitalité de son écoute.
« In ipso vita et lux. » Que cette lumière du Seigneur illumine les décisions de nos dirigeants, éclaire leur conscience et leur donne le courage et la force de se mouvoir exclusivement et pleinement dans le Jub Jubal Jubanti, tout en les préservant du malin génie.
François Mame Samba NDIAYE
Juriste, Expert en médiation, conciliation et arbitrage
Spécialiste certifié des aspects légaux et pratiques du commerce électronique
Commentaires (0)
Participer à la Discussion